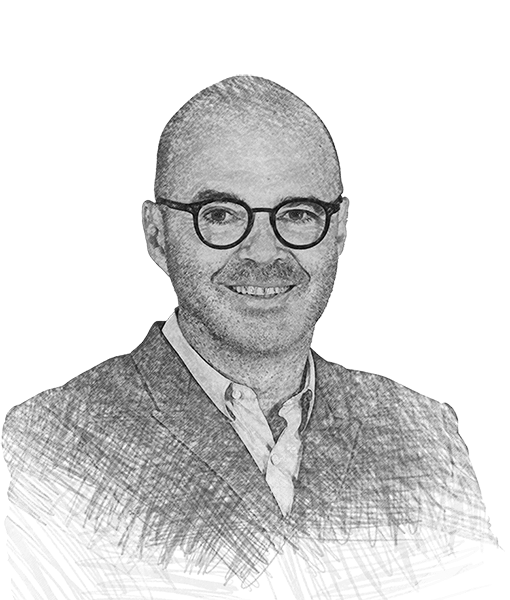La concurrence renvoie souvent les dirigeants à deux univers bien différents : celui de l’émulation, de la compétition, de l’innovation, stimulant à leurs yeux ; et celui du droit de la concurrence, où les autorités qui en ont la charge sont perçues par eux avant tout comme des censeurs dans la mise en œuvre de leurs stratégies d’entreprises.
Pourtant, difficile d’être libéral sans souscrire à l’idée que la préservation de la concurrence est indispensable à la vigueur de nos économies. Et comment être attaché à l’esprit d’entreprise sans reconnaitre que les autorités en question jouent un rôle central dans la création de valeur ?
Mais l’exigence d’efficience doit porter sur tous les acteurs d’un marché, y compris lesdites autorités.
Dès lors, il leur incombe d’être en phase avec les réalités économiques des marchés et donc aussi avec le fonctionnement des entreprises. Et il est indispensable également que les autorités prennent en compte les conséquences de leurs décisions, en ayant une vision dynamique du fonctionnement concurrentiel des marchés, qui va bien au-delà de l’analyse de leur état à un moment donné.
Ce qui est en jeu, n’est ni plus ni moins, que l’existence dans l’entreprise d’une sincère considération pour le droit de la concurrence et le souci d’en respecter les règles. Or, de nombreuses entreprises ont cette volonté mais elles sont encore souvent incomprises ou empêchées.
Il est indispensable que les autorités aient une vision dynamique du fonctionnement des marchés, au-delà de l’analyse de leur état à un moment donné.
Par exemple, relever les défis de la transition énergétique exige des coopérations poussées entre entreprises sans lesquelles ni les investissements majeurs qui sont nécessaires ne pourront être réalisés, ni les innovations les plus radicales ne pourront être rendues possibles. Cela supposerait parfois qu’elles puissent conclurent entre elles des ententes, certes anticoncurrentielles, mais vertueuses pourtant au regard des objectifs de durabilité. Encore faudrait-il que les autorités de concurrence acceptent de considérer cette idée et changent leurs critères d’analyse pour, dans certains cas, les autoriser.
Autre illustration : faire comprendre et donc respecter le droit de la concurrence par les opérationnels et les dirigeants réclame que la communication dans l’entreprise soit fluide et naturelle sur ces sujets et pratiques. Mais comment peut-elle l’être quand la suspicion est permanente lors des échanges avec les autorités ? Quelles méthodes adopter d’ailleurs sans legal privilege pour les directeurs juridiques, ni protection des informations remontées par les enquêtes internes, alors qu’il s’agit là d’outils précieux pour identifier les problèmes et y remédier ?
Sur tout cela, nous sommes heureux d’avoir réuni non seulement des experts externes remarquables, mais aussi deux représentants de haut niveau du monde de l’entreprise, confrontés quotidiennement à ces sujets dans leurs prises de décisions. Bonne lecture.