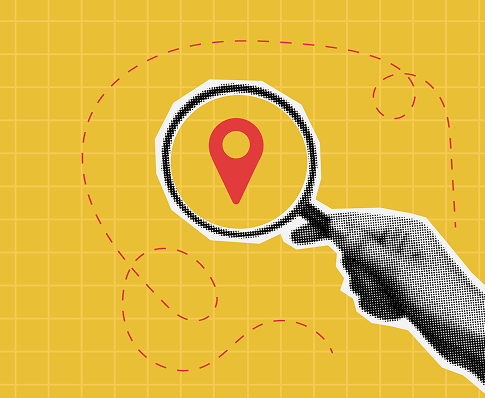Kelig Bloret-Dupuis, directrice juridique Concurrence & Antitrust du groupe EssilorLuxottica et intervenante à l’Université de Rennes, et Faustine Viala, avocate, associée du cabinet Willkie Farr & Gallagher y dirigeant le département Competition & Antitrust à Paris, apportent sur ces questions un éclairage aussi concret que constructif.
En droit de la concurrence notamment, la question du legal privilege des juristes d’entreprises demeure un sujet d’actualité, en dépit des multiples revirements des nombreux projets visant à l’instaurer. Quels en sont les enjeux au regard de votre pratique ?
Kelig Bloret-Dupuis : Aujourd’hui, j’en identifie trois principaux. D’abord, des barrières psychologiques doivent encore tomber. Un certain nombre d'intervenants considèrent toujours que le legal privilege empêcherait que les entreprises soient poursuivies, que des pratiques soient identifiées et qualifiées. L’expérience acquise dans d’autres pays, anglo-saxons par exemple, montre qu’elle ne porte pas du tout atteinte à une bonne pratique de la justice et ni aux interventions des autorités et des juges.
Il existe ensuite un enjeu lié aux praticiens du droit en règle générale. Avocats, juristes : nous participons tous à bien faire comprendre et appliquer les règles de droit, à trouver des solutions en conformité avec les règles. Dès lors, il est délicat de considérer que sur un même sujet, un même avis soit protégé ou non selon l’identité du professionnel qui l’émet. Cela ne fait pas sens.
Enfin, le fait de ne pas bénéficier du legal privilege emporte quand même quelques conséquences négatives. Il y a notamment des cas de jurisprudence où des écrits de juristes internes ont été utilisés à charge contre l'entreprise. Dès lors, pour ne pas porter atteinte aux intérêts de l'entreprise, puisqu'on ne peut pas protéger ses écrits, on écrit moins. La diffusion et la compréhension des problématiques par le plus grand nombre dans l’entreprise est ainsi plus compliquée. Cela ne profite à personne.
Et n'oublions pas que la réforme de l’an dernier n'était pas censée « ouvrir les vannes » sur ce sujet. Elle ne prévoyait de donner la possibilité d’émettre des consultations protégées qu'à un petit nombre de juristes - plutôt de directeurs juridiques d’ailleurs - s'adressant à la direction de l'entreprise.
En droit de la concurrence, ne pas pouvoir écrire les choses fait perdre du temps, peut créer des tensions, des compréhensions partielles sources d’insatisfaction et de transmission d’informations incomplètes ou erronées.
Kelig Bloret-Dupuis
directrice juridique Concurrence & Antitrust EssilorLuxottica
Cette absence complique-t-elle la diffusion d’un bon niveau de connaissance des exigences du droit de la concurrence auprès des opérationnels les plus concernés ?
K. B.-D. : Le droit de la concurrence s'intéresse avant tout aux stratégies et pratiques commerciales et marketing. Notre rôle au quotidien se situe là. Or, bien souvent, les projets évoluent rapidement et la réactivité est la clef de l’efficacité. Le fait de ne pas pouvoir écrire les choses, et donc guider, de ne pas pouvoir clairement proposer des options par écrit, fait perdre du temps et peut créer des tensions, des compréhensions partielles qui sont autant de sources d’insatisfaction et de transmission d’informations incomplètes ou erronées.
Faustine Viala : Le point majeur est en effet cette meilleure collaboration possible, au sein de l’entreprise, entre juristes, avec les dirigeants, les équipes, mais aussi avec l’avocat de l’entreprise. Depuis quelques années, des clients nous demandent des formations sur le legal privilege et sa pratique aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays et continents. L’objectif est de savoir ce qu’un juriste peut écrire et ce qu’il ne doit pas écrire et de savoir comment traiter ces informations, selon l’interlocuteur, les pays concernés...
De facto, cela limite le rôle du juriste d’entreprise français au lieu de provoquer un effet vertueux, positif pour le respect du droit, notamment en matière de droit de la concurrence où la diffusion du savoir auprès des dirigeants et des opérationnels est clef. Si l'application du droit est gérée par le juriste en interne, on aura moins d'affaires derrière et on aura moins de violations du droit de la concurrence. Il est difficile de comprendre cette défiance des autorités publiques, tout de même plus notable en France qu’ailleurs.

L’autre versant de la protection des intérêts de l’entreprise en droit de la concurrence est celui de ses droits de la défense, notamment dans le cadre des procédures contentieuses. Faut-il les considérer comme affaiblis ?
K. B.- D. : Que ce soit en France ou en Europe, nous avons un cadre institutionnel, un état de droit, qui établit et qui protège les droits des justiciables devant les autorités et les juridictions d’appel. Je pense aussi que sous l'impulsion de la Commission européenne, par les textes qu’elle adopte ou par ses initiatives – à tout le moins en droit de la concurrence, l'idée est toujours de développer ces droits et de s'assurer que, dans les différents États membres, ces règles existent, soient appliquées et respectées. Aujourd’hui, il me semble que ce cadre institutionnel est un socle majeur de l’Union européenne et de ses membres à préserver. Néanmoins, des améliorations sont à la fois possibles et souhaitables, sans obligatoirement nécessiter d’évolution législative d’ailleurs.
Par exemple, le déroulement des contentieux se trouverait amélioré si les entreprises étaient écoutées à différents moments de la procédure. En matière contentieuse, deux phases se succèdent : une phase d’enquête et une phase contradictoire. La seconde commence par l’envoi d’une notification de griefs aux entreprises, qui précise les griefs qui leur sont imputés et leur qualification juridique. L’exercice de la défense consiste à répondre à ces griefs. Mais cette réponse s’inscrit dans un exercice très formel où les entreprises doivent réagir selon la grille d’analyse établie par la jurisprudence pour contester les faits et la qualification d’une pratique. Il ne s’agit pas d’une explication mais d’une défense. Or, l’exercice des droits de la défense devrait jouer avant que l’on arrive à cette étape, c’est-à-dire pendant la phase d’enquête.
Souvent en effet, l’entreprise n’est pas auditionnée pendant la phase d’enquête alors même que le droit de la concurrence est, par essence, un droit économique : par définition, la démarche des autorités s'appuie sur l'identification d'un marché, réclame de comprendre ses dynamiques, ses acteurs, les produits et les services qui s’y échangent, le type de concurrence qui s’y exerce. Toutes ces réalités économiques sont des prérequis pour aboutir à des qualifications juridiques de pratiques. La valeur d’une discussion à ce moment-là, c’est-à-dire dès la phase amont de l’enquête, me semble importante pour éclairer les faits. Les autorités elles-mêmes n’ont rien à y perdre. Par le passé, de telles auditions existaient. Il n’y a pas de raison objective à ce qu’elles ne soient pas de nouveau possibles.
Par ailleurs, il peut arriver que l’on fasse valoir nos droits de la défense, dans le cadre de procédures telles que les opérations de visite et saisie. Il est difficile d’entendre alors les représentants des autorités s’en plaindre et indiquer que la longueur des procédures, que nous critiquons par ailleurs, s’expliquerait par l’exercice de nos droits de la défense.
F. V. : Cette question comporte aussi un sujet sur le timing. Le temps de la procédure des autorités de concurrence n'est pas le temps des affaires. Dès lors que la Commission adresse des demandes d’informations, les entreprises concernées ne savent pas ce qui se passe. Et elles peuvent être laissées sans information complémentaire pendant des années, sans savoir s’il faut ou non qu’elles changent des pratiques, ni savoir exactement d’ailleurs lesquelles sont concernées. L’absence de transparence et de célérité ne produit pas nécessairement les meilleurs effets sur le marché.
Dans le cadre de cette défense, à défaut de legal privilege pour les juristes d’entreprises, la confidentialité des communications entre l’entreprise et son avocat joue un rôle majeur. Est-elle en danger ?
F. V. : Elle l’est et ce n’est pas nouveau. Toute la profession se mobilise car le légal privilege de l’avocat est mis à mal. Il est en danger, en particulier en France. Ce mouvement s'appuie sur des jurisprudences de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui nous expliquent, de manière constante, et encore très récemment en septembre 2024, que les saisies de correspondances avocat-client sont possibles dès lors qu’elles ne relèvent pas uniquement des droits de la défense. Cette approche en réduit nettement le champ. Or, ce qui serait conforme à la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’Homme, c'est que la totalité des correspondances avocat-client ne soit pas saisie, y compris celles où l’avocat intervient en tant que conseil, et pas uniquement celles relatives aux droits de la défense.
La France n'est pas en ligne avec ce qu'on constate en Europe, y compris avec la Commission européenne. Le dialogue avec les entreprises, dès les phases d’enquêtes, permettrait une meilleure information des autorités. Le legal privilege pour les juristes d’entreprises assurerait une communication plus fluide et plus efficace au sein des entreprises pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles. La confidentialité absolue des correspondances entre l’avocat et son client, est, elle aussi, un facteur de respect du droit.
Le legal privilege pour les juristes d’entreprises assurerait une communication plus fluide et plus efficace au sein des entreprises pour prévenir les pratiques anticoncurrentielles.
Faustine Viala
avocate, associée, Willkie Farr & Gallagher
En matière de concurrence, les entreprises ont recours parfois à des enquêtes internes et audits, souvent en collaboration avec des experts externes, dont des avocats. Là encore, se trouve posée la question du traitement et de la protection des informations remontées. Dans quels cas intervenez-vous ?
F. V. : En matière d’audit concurrence, plusieurs cas se présentent à nous. Des clients peuvent conduire des audits généraux, sur la finance et le juridique, incluant la conformité au droit de la concurrence. C’est le cas notamment quand un groupe a récemment intégré une nouvelle société. Mais la pratique existe aussi, au fil de l’eau, sur certaines filiales, plus sensibles que d’autres. D’autres audits sont déclenchés à la suite d’un soupçon et la réalisation de celui-ci doit se faire davantage dans l’urgence. Enfin, il y a les actions engagées par l’entreprise, dans le cadre des enquêtes de la Commission européenne, afin d’identifier les éléments permettant de répondre aux demandes d’informations formulées par la direction de la concurrence. Il faut alors être assez exhaustif et cela passe par une enquête incluant courriels, cloud, messageries Whatsapp notamment. La coopération de tous les salariés n’est pas nécessairement acquise, ce qui rend indispensable une saisie complète et approfondie de toute forme d’échanges afin de ne passer à côté d’aucun élément
Avec les audits et enquêtes internes, les défis sont de respecter tous les cadres qui s’imposent, de protéger les éléments d’informations remontés et de faire face aux éventuels non-alignement des intérêts de l’entreprise et des salariés concernés.
Faustine Viala
avocate, associée, Willkie Farr & Gallagher
A quels enjeux confrontent-ils les entreprises et leurs avocats ?
F. V. : J’en vois de deux catégories. La première catégorie réunit les enjeux concernant la réalisation de ces opérations. Il s’agit de respecter tous les cadres qui s’imposent à nous. En matière de droit social, mais aussi de protection des données, qu’elles soient personnelles ou des données sensibles. La difficulté vient de la diversité des règles selon les pays concernés mais aussi du statut particulier de certains pays. Par exemple, si l’enquête que l’on conduit doit déboucher sur l’envoi aux Etats-Unis d’informations sensibles, il faut obligatoirement passer par le Service de l'information stratégique et de la sécurité économiques (SISSE) du ministère de l’Économie. Il peut y avoir également des enjeux éthiques quand il faut déterminer par exemple s’il est opportun ou pas d’interroger des personnes en position de faiblesse ou de fragilité avérée. En règle générale, les entreprises les plus importantes ont des directions dédiées (données, éthique…) et des règles internes qui prévoient ces situations. La réalisation de ces opérations en est facilitée.
L’autre catégorie réunit les enjeux relatifs aux résultats de cet audit, en particulier à l’usage et à la protection des éléments d’information qui auront été remontés via ces audits et enquêtes internes. Cela appelle une grande prudence avec le rapport d’audit qui est réalisé, y compris à propos de son support, du cadre et de la manière de le présenter. Sur les sujets les plus sensibles qu’il pointe, des décisions stratégiques sont attendues. Prises par la direction, elles supposent une fluidité d’échanges d’informations entre plusieurs acteurs, ce qui est en soi facteur de risque. Un bon avocat concurrence doit être alerte sur ces sujets-là. Enfin, il existe l’enjeu de l’alignement, ou pas, des intérêts de l’entreprise avec ceux des salariés concernés. En cas de divergence, il faut expliquer au dirigeant, à son directeur juridique, que tel ou tel salarié va devoir mandater son propre avocat. Là encore, il y aurait un côté vertueux à assurer que ces échanges soient mieux couverts par le secret des correspondances entre l’avocat et son client.
Les changements économiques et géopolitiques récents conduisent les acteurs à s’adapter ou à se transformer. Faut-il aussi adapter le droit de la concurrence pour qu'il reste pertinent à l’aune de ces réalités économiques nouvelles ?
K. B.- D. : C’est un domaine du droit qui, normalement, devrait vraiment être en phase avec la réalité économique. Et je reconnais que le rôle des autorités n'est pas simple notamment en matière de contrôle des concentrations car elles doivent faire une analyse prospective des effets potentiels d'une acquisition ou d'une fusion, sur les dynamiques de marché.
Cette analyse repose sur trois piliers : les tests de marché, l’exploitation de documents internes aux entreprises et, enfin, les tests économiques. Pour réaliser ces derniers, des indicateurs simples sont utilisés, comme le taux de marge. Or, ils ne sont pas calculés de la même manière par les entreprises et par les autorités. Mais elles ont également recours à des tests beaucoup plus poussés comme les UPP (Upward Pricing Pressure) ou les GUPPI (Gross Upward Pricing Pressure Index). Or, ces outils ne sont pas utilisés par les entreprises pour déterminer l’intérêt d’une importante opération, ni par les cabinets d’avocats pour évaluer les risques antitrust associés. Ainsi, le droit de la concurrence se fonde sur des théories économiques sur la base desquelles sont forgés des outils d’analyse qui ne reflètent toujours pas la réalité économique telle qu’elle est vécue par les acteurs des marchés.
Il ne s’agit pas de remettre en cause ces tests car ils sont également très utiles. Mais il faut veiller à ne pas rester trop théorique. Ainsi, si des tests économiques concluent à un risque d'affectation sensible de la concurrence sur un marché, ils ne devraient être retenus par une autorité de la concurrence que si la théorie est corroborée par des documents internes de l’entreprise, un plan stratégique.
Ainsi, pour répondre à votre question relative aux changements économiques et géopolitiques, il faut avant tout s’appuyer sur les fondamentaux du droit de la concurrence, et trouver ou maintenir un équilibre entre les tests de marché, les documents internes et les tests économiques avant de conclure une analyse
Si la politique de concurrence était pensée de manière articulée avec la politique industrielle, la politique de l'innovation, les effets seraient plutôt positifs pour les marchés et donc pour les consommateurs. C'est aussi une façon de promouvoir l'Europe.
Kelig Bloret-Dupuis
directrice juridique Concurrence & Antitrust EssilorLuxottica
F. V. : Comme dans les procédures contentieuses, il faudrait un peu plus de transparence et d'échanges. Cela permettrait notamment d’expliquer aux autorités, plus en amont, la rationalité économique d’une opération. Les autorités publient régulièrement des lignes directrices ou « guidelines » qui sont là pour mieux guider les entreprises et consultent d’ailleurs le marché en amont afin de recueillir leur opinion sur le texte de ces guidelines. Ce sont des initiatives qui sont clairement appréciées par les entreprises et les praticiens mais qui restent encore parfois d’un impact limité. Les entreprises ont besoin encore davantage de cohérence, de prévisibilité et de sécurité juridique dans l’application du droit de la concurrence. Par ailleurs, dans le contexte actuel, la politique industrielle européenne et la défense de nos champions européens, notamment, devraient être davantage prises en compte
K. B.- D. : Comme beaucoup de professionnels le soutiennent, si la politique de concurrence était pensée de manière articulée avec d'autres politiques, comme la politique industrielle, la politique de l'innovation, les effets seraient plutôt positifs pour les marchés et donc pour les consommateurs. C'est aussi une façon de promouvoir l'Europe.
Faut-il s’attendre à des changements dans la pratique des autorités américaines en matière de concurrence ?
K. B.- D. : C’est un sujet qui est naturellement regardé avec beaucoup d’attention et qui appelle la plus grande prudence, même si cela fait de nombreuses années que les autorités américaines sont très actives, y compris vis-à-vis des entreprises étrangères.
F. V. : Pour l'instant, il est bien difficile de savoir ce qui va se passer. Il faut rester pragmatique. Le nouveau « form HSR» (le dossier à remplir en merger control aux Etats-Unis) a complètement été revu et il est devenu beaucoup lourd en termes d’informations et analyses requises (s’apparentant davantage au Form CO européen). Trump n’y a pas touché bien qu’il s’agissait d’un projet initié et validé sous l’administration Biden. Ensuite, la tendance sous l'administration Biden était d'aller très souvent en contentieux sur des opérations de concentration complexes, avec une prévisibilité totalement nulle pour les parties. Est-ce que cette tendance va être stoppée net ? Il est bien trop tôt pour le dire. Nous restons très prudents sur ce qu’il adviendra. Enfin, sur toutes les grosses opérations transatlantiques, au-delà du merger control, le CIFIUS (comité inter-agences du gouvernement des États-Unis chargé de l'examen des investissements étrangers dans les entreprises américaines pour des raisons de sécurité nationale) est un outil dont il va falloir encore davantage anticiper les effets.