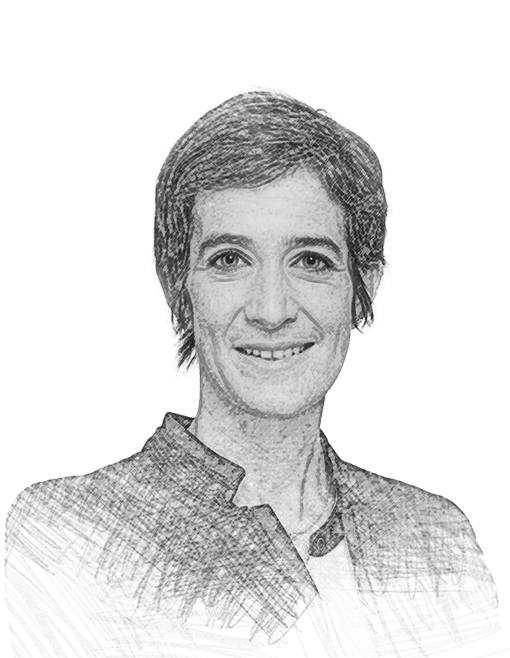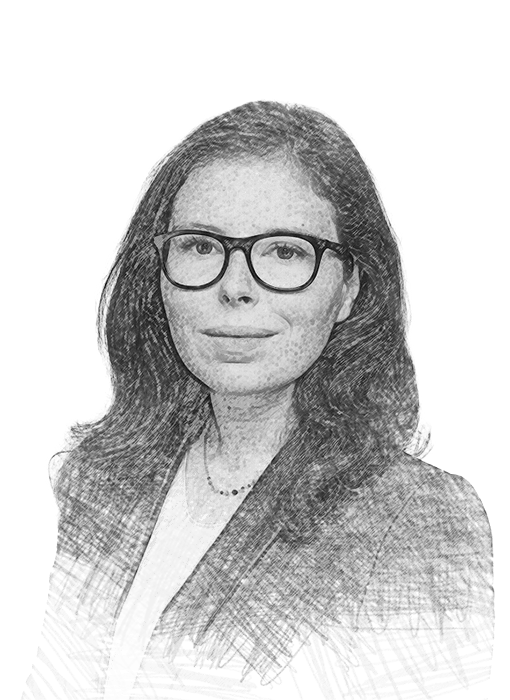Pour atteindre les objectifs de transition énergétique que la France s’est fixés, les pouvoirs publics ont pris de nombreuses mesures favorables à la réduction de l’empreinte carbone du secteur du bâtiment. Ces mesures devraient accroître la demande en matériaux et techniques nouvelles et favoriser le développement d’une industrie verte tournée vers le secteur de la construction.
De nombreuses mesures favorables à la réduction de l'empreinte carbone du secteur du bâtiment devraient favoriser le développement d'une industrie verte.
Anne-Laure Gauthier Avocate, associée, Lacourte Raquin Tatar
Renforcer les exigences environnementales du secteur du bâtiment
Le Code de la commande publique a ainsi été modifié pour inviter les acheteurs publics à mieux prendre en compte les conséquences environnementales de leurs contrats : par l’adoption d’un SPASER1 ; par l’exclusion des entreprises qui ne satisfont pas à certaines obligations environnementales ; mais aussi par la possibilité de prendre en compte l’aspect écologique dans leur sélection de la meilleure offre.
Les normes de construction ont été durcies : par le décret tertiaire en 2019 imposant aux propriétaires de bâtiments à usage tertiaire d'engager des actions pour réduire les consommations d'énergie de leurs immeubles afin d'atteindre des objectifs fixés par la loi ; par l’entrée en vigueur de la RE2020 en 2022 pour favoriser l’efficacité thermique des bâtiments neufs, ou encore par la REP2 bâtiment en 2023 pour améliorer le réemploi de matériaux de chantier.
Des mesures sont imposées aux propriétaires qui procèdent à des travaux sur leurs immeubles :
- amélioration de la performance énergétique des bâtiments d'une SHON supérieure à 1.000 m2 lorsque sont engagés des travaux de rénovation portant soit sur son enveloppe et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe, et dont le coût total prévisionnel est supérieur à 25 % de la valeur du bâtiment3 ;
- travaux d'isolation thermique dans certains bâtiments4 dès lors que des travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture sont réalisés5 ;
- amélioration des caractéristiques des équipements de l'immeuble (chauffage, climatisation, éclairage, ventilation) à l'occasion de leur mise en place ou de leur remplacement6.
Les propriétaires d'immeubles à usage d'habitation doivent faire déterminer leur niveau de performance énergétique selon la méthode du diagnostic de performance énergétique (DPE)7 et sont sanctionnés, si le DPE présente une faible performance énergétique au regard des exigences légales8, par l'interdiction de louer le logement à certaines échéances.
Certaines mesures visent ensuite à favoriser la demande de nouveaux équipements relatifs à la production d'énergies renouvelables et aux nouvelles mobilités durables :
- l'obligation pour les constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, de bureaux ou d'entrepôt créant plus de 500 m2 d'emprise au sol et leur extension ou rénovation lourde, lorsqu'elles ont une emprise au sol de plus de 500 m2, d'intégrer un procédé de production d'énergies renouvelables, ou un système de végétalisation particulier ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat9 ;
- l'obligation pour les aires de stationnement associées aux bâtiments précités d'intégrer des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales et des dispositifs végétalisés ou des ombrières concourant à leur ombrage sur au moins la moitié de leur surface ;
- l'obligation pour les propriétaires de parkings d’une superficie de plus de 1.500 m2 de les équiper d'ombrières photovoltaïques intégrant un procédé de production d'énergies renouvelables10 ;
- l'obligation pour les propriétaires de certains immeubles de pré-équiper et/ou équiper certains emplacements de stationnement d'équipements dédiés à la recharge de véhicules électriques et/ou hybrides11.
Ces mesures s'inscrivent dans le cadre plus général des obligations d'information sur leur impact environnemental mises à la charge des grandes entreprises et fonds d'investissement par la directive sur le reporting de durabilité (CSRD) ou le règlement sur la finance durable (SFDR). Ces mesures s'imposent notamment aux grands opérateurs dans le domaine de l'immobilier. Ces derniers les répercutent à leurs fournisseurs et partenaires, ce qui a un effet d'entraînement sur toute la filière immobilière.
Simplifier l’implantation de sites industriels
Le contexte réglementaire français pose un réel défi à la construction de sites industriels. Il exige des mesures pour simplifier la mobilisation du foncier et l’obtention des différentes autorisations administratives nécessaires.
En premier lieu, dans la mesure où la France vise une réduction de l'artificialisation des sols en limitant les secteurs constructibles dans les documents d'urbanisme, l’adaptation de ces documents est un enjeu majeur de la création de sites industriels. Ainsi, la loi industrie verte12 impose aux SRADDET13 de les prendre en compte pour harmoniser la planification industrielle au niveau régional. Elle dicte également aux pouvoirs publics d’identifier, dans les SCOT14 et les PLU15, des friches qui seront favorisées pour l’implantation de nouveaux projets industriels. Devront également être repérés les espaces favorables à la création de Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR). Ces sites renaturés permettront à des porteurs de projet de générer et d’échanger des quotas carbones tout en luttant contre l’artificialisation des sols.
Dans cette logique d’identification de terrains favorables à l’industrie, le gouvernement a initié le dispositif des « sites clés en main »16, qui vise à sélectionner des sites au regard de leur potentiel industriel et à accompagner les porteurs de projets pour assurer le bon déroulement des procédures d’études, de financement, et d’autorisations administratives.
Simplifier l'implantation de sites industriels est un levier pour une réindustrialisation verte.
Louise-Victoire David Collaboratrice, Lacourte Raquin Tatar
Faciliter le réemploi des friches industrielles
Tel est l’objectif du décret du 6 juillet 202417 qui simplifie la cessation d'activité des ICPE18, obligeant les exploitants à réhabiliter les sites pollués en concertation avec la préfecture. Celle-ci peut permettre le maintien de pollutions résiduelles, mais également forcer la cessation d’installations inexploitées depuis plus de trois ans et procéder à des expropriations pour favoriser l’implantation de sites industriels. Enfin, la procédure de tiers demandeur est révisée pour permettre un partage de la charge de dépollution entre le vendeur et l’acquéreur d’une friche19.
Les récentes évolutions du droit permettent également la modification des documents d’urbanisme pour les mettre en compatibilité avec des projets industriels. Cette procédure est désormais ouverte pour les installations nécessaires à la production durable dans les secteurs des technologies vertes (géothermies, batteries, panneaux photovoltaïques…)20. Mais aussi par la reconnaissance à certaines opérations d’un nouveau statut de projet d'intérêt national majeur21.
En deuxième lieu, l’adaptation de la réglementation à la réindustrialisation nécessite d’accélérer l’instruction des autorisations environnementales. Cette accélération est notamment permise par le déroulement en parallèle de la phase de consultation du public et celle d’examen du projet par les services instructeurs ainsi que par l’évolution des enquêtes publiques22. Ces nouveautés permettront de réduire de plusieurs mois l’instruction des autorisations. Par ailleurs, pour éviter que des projets ne soient ralentis par des recours injustifiés le juge administratif pourra désormais prononcer des condamnations pour recours abusif23.
Enfin, l’obtention d’une dérogation espèce protégée sera plus aisée à l’avenir pour les projets qui auront reçu le statut de projet d'intérêt national majeur. Ces projets pourront en effet bénéficier d’une reconnaissance anticipée de la raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) qui est une des conditions d’obtention de cette dérogation24.
L’évolution réglementaire favorisant une réindustrialisation verte ne fait cependant que commencer. L’Union européenne a en effet présenté le 29 janvier 2025 sa « Boussole de la compétitivité »25. Le plan de l’Union repose sur un effort de simplification portant sur la finance, la taxonomie et la délivrance d’autorisations ainsi que sur un soutien aux entreprises via des préférences dans les marchés publics, des règles simplifiées pour les aides d'État, des garanties pour les investisseurs et l’accès à une énergie abordable.
Résumé
- Les politiques publiques visant à atteindre la neutralité carbone favorisent l’émergence d’une industrie verte tournée vers le secteur du bâtiment.
- Les modifications des règles de la commande publique et des normes de construction renforcent les exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs comme existant et ont pour conséquence d’augmenter la demande de technologies décarbonées.
- En parallèle, le Gouvernement cherche à faciliter l’implantation de nouveaux sites industriels, notamment par le recyclage de friches industrielles, la simplification des démarches administratives et la mise en place des financements nécessaires aux projets.
1 Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables
2 Responsabilité élargie du producteur
3 CCH, art. R.173-2
4 Bâtiments et parties de bâtiments existants, d'une surface de plancher supérieure à 1.000 m2, dont la date d'achèvement de la construction est postérieure au 1er janvier 1948 (art. 1er et 2, arrêté du 13 juin 2008)
5 CCH, art. L.173-1, al. 1er
6 CCH, art. L.174-3, L.175-2 et R.173-3
7 CCH, art. L.173-2
8 Article 3 bis du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifié par le décret n°2023-796 du 18 août 2023.
9 CCH, art. L.171-4
10 Article 40 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables11 CCH, art. L.113-11 à L.113-17, L.181-11 à L.181-14, L.183-4 et R.113-6 à R.113-10 et art. L. 113-16
11 CCH, art. L.113-11 à L.113-17, L.181-11 à L.181-14, L.183-4 et R.113-6 à R.113-10 et art. L. 113-16
12 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023
13 Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
14 Schéma de cohérence territoriale
15 Plan local d’urbanisme
16 Communiqué de Presse, 17 avril 2024, Christophe Béchu, Dominique Faure et Roland Lescure dévoilent la liste des 55 premiers sites clés en main France 2030, N°1776
17 Décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024
18 Installation classée pour la protection de l’environnement
19 C.env L.512-21
20 C.urb art R.300-14
21 C.urb art L.300-6-2
22 C.env art L.181-10-1
23 C.env art L. 181-17
24 C.env art R.411-6-2
25 Communication de la Commission Européenne, 29 janvier 2025, A Competitiveness Compass for the EU, COM/2025/30 final